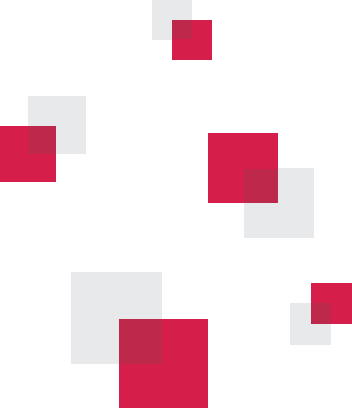A l’origine, streetwork (travail de rue) émane des travaux de l’école de Chicago (USA) au milieu des années 20 sous l’impulsion de Shaw et McKay, deux sociologues qui étudiaient la criminalité et la délinquance de groupes de jeunes marginalisés (Specht 2010). A l’issue de la deuxième guerre mondiale en France (Peyre, Tétard 2006) ou au milieu des années 60, les premiers projets apparaissent en Europe (Grande-Bretagne, Hollande, Allemagne, etc.). En 1971 et s’appuyant sur des expériences d’action sociale extra-muros aux Etats-Unis, Alinsky écrira un manuel de l’animateur social (Alinsky 1976), ouvrage ayant inspiré un certain nombre de politiques de la jeunesse.
Contexte helvétique En Romandie, sous l’influence de la prévention spécialisée française, le travail de rue connaît ses premiers balbutiements au travers d’actions caritatives, en dehors des lieux de culte usuels. A la fin des années 80, il apparaît au sein d’institutions actives dans les champs de la prévention et la réduction des risques (alcool, psychotropes, MST, etc.). Ces dernières orientent leurs activités en milieu ouvert face à une recrudescence de jeunes gens attirés par l’errance de la « scène drogue ». Depuis les années 2000, à l’heure où les préoccupations sociales, sanitaires et sécuritaires vont grandissant et où les politiques de la ville se dotent de service jeunesse, il connaît une réelle émergence. Il est alors de plus en plus fréquent d’entendre parler d’« éducateur de rue », de « travailleur social de proximité », d’« animateur de rue », de « médiateur de rue », de « travailleur de rue » et, à dessein de lui trouver une terminologie commune, il sera désigné sous le nom de travail social hors murs (TSHM) par une plateforme de professionnels suisses romands.
Dans la région du Tessin, face à des problèmes récurrents d’incivilité et au regard du succès des modèles romands, des postes de travailleurs sociaux hors murs commencent à voir le jour autour de 2010.
Le travail de rue offre un terrain d’essai fertile pour renouveler les façons de prendre des décisions démocratiques et participatives.
En Suisse alémanique, sous l’influence du modèle allemand (Stuttgart), lui-même inspiré des travaux américains soulignant l’importance de travailler avec la communauté de base, il naît plutôt dans la région de Zurich dans les années 80 et autour des questions liées à la consommation de drogue dans l’espace public (Maurer 1992, p. 9). A ce jour, il est encore présent dans les projets de prévention et de réduction des risques (projets mobiles, milieux festifs, etc.), le travail des églises et les pratiques de l’animation socioculturelle (Association faîtière pour l’animation jeunesse en milieu ouvert, DOJ) qui s’intéressent de près aux actions des travailleurs sociaux murs. Néanmoins, la tendance à voir naître certains dispositifs, le plus souvent insufflés et encadrés par les métiers de l’ordre, axés sur le contrôle social et la surveillance (SIP, sociétés privées de sécurité) et caractérisés par le port d’un uniforme, l’exécution de rondes urbaines et une proximité de convenance, se fait sentir dans la rue. Une visée « sécuritariste » qui se propage en Suisse romande sous les désignations de « parrain de gare », « correspondant de nuit » ou « médiateur citoyen ». Si l’intention de se rapprocher de la société civile est louable, les intervenants s’exposent à des situations de rue bien souvent complexes auxquelles ils ne sont pas outillés à faire face et leur intervention en uniforme, associée à la notion de contrôle, véhicule intrinsèquement l’idée d’une défiance à l’égard des citoyens.
« Le sécuritarisme, c’est tout simplement l’obsession folle de vivre dans la sécurité absolue. C’est le principe de précaution poussé à l’infini. Ce dernier vise à essayer de se prémunir de tout, à tisser un filet de plus en plus serré sur toute la société pour se protéger des déviants, des gens qui marchent en dehors des clous. On le vit un peu tous les jours sans s’en rendre compte mais nous n’en sommes qu’aux prémices. Sans savoir où cela mène. Au début, le sécuritarisme rassure. Il joue sur l’émotion. Or, l’émotion est neutre, on n’y trouve ni le bien ni le mal, ni la démocratie ni le totalitarisme. Mais elle est aussi manipulable. En l’occurrence, on la suscite aujourd’hui contre les libertés, contre l’espoir, et jamais dans le sens de l’humain. »
Extrait tiré d’un interview du magistrat judiciaire, enseignant et essayiste français Serge Portelli publié par la revue Témoignage Chrétien du 14 mai 2011 (www.temoignagechretien.fr).
Nature du travail social de rue Inscrit aux confins de multiples disciplines, le travail de rue agit à la base de la communauté et a pour buts de construire du lien social et une relation de confiance, de contribuer à l’émancipation des individus – en priorité ceux en proie à des processus d’exclusion et de précarisation –, de dresser des passerelles et permettre l’accès aux diverses structures existantes, de faire émerger les questions et problématiques apportées par la population – ou les instances qui la représentent – auprès des autorités politiques, de tendre vers une cohésion sociale, de rendre la communauté attentive aux richesses et potentialités de chacun de ses membres et de produire des formes nouvelles de démocratie directe et participative, offrant ainsi la possibilité d’inclure ceux qui boudent les urnes ou les « sans voix » (ex-détenus, migrants et, plus généralement, toutes les personnes dans l’incapacité de voter ou sans titre de séjour). Il s’agit aussi de redonner du pouvoir d’agir à des personnes en situation de vulnérabilité sociale, économique, affective, sanitaire et, par là même, contribuer à la reconnaissance de leur histoire comme partie intégrante de la communauté et favoriser la participation citoyenne.
La présence dans la rue et dans les milieux de vie de la population est au cœur de l’activité. Ainsi, au gré et au rythme des rencontres avec la population, le travailleur de rue prend le pouls de la société, relève les ressources et les doléances des habitants, facilite et transmet des informations liées à la vie de la cité ou à son fonctionnement. Autour de ces présences, il effectue un travail de sensibilisation (promotion de la santé, réduction des risques, expertise communautaire et recommandations p. ex.) tant auprès des publics que des autorités, un appui à l’auto-organisation des personnes (un collectif de sans-abris p. ex.), et enfin, des activités propres (musique, sport, etc.) au travers desquelles il peut se fondre dans la masse et être plus accessible du grand public. Il agit selon des principes de libre adhésion, de respect de l’anonymat et d’absence de mandat nominatif et n’a pas pour fonction d’imposer, d’interdire ou de normaliser un comportement.
Un monde de liens Le travailleur de rue tisse des liens avec la population en général1 et, plus spécifiquement, avec des jeunes et des adultes concernés par des situations d’exclusion, d’isolement, de précarité, de maltraitance ou de maladie. Il est également en contact avec diverses autres populations (petite enfance, parents, aînés), en particulier lorsqu’il oriente son action dans une dynamique communautaire, sur un quartier p. ex. Couramment désignées selon les termes de bénéficiaire, d’usager voir de client, ces populations sont aussi des partenaires (réels ou potentiels). Bien souvent, elles disposent en effet de ressources incommensurables dans la connaissance des terrains que le travailleur de rue investit. Une dynamique qui le conduit bien souvent à entrer d’abord en contact avec le réseau naturel (famille, amis, etc.) desdites populations. Au niveau du réseau plus élargi, il est en lien avec diverses institutions dont les services municipaux (social, culture, police, sport, urbanisme, etc.), le milieu associatif, un centre carcéral, des médecins, l’école, des centres de réinsertion, des structures de formation, des services cantonaux et fédéraux (tribunaux, addiction, culture, intégration, sport, territoire, etc.), des communautés de migrants, des sociétés sportives et culturelles, des structures dédiées à la prévention et la promotion de la santé, un centre de soins psychiatriques, des œuvres caritatives, etc. S’il est d’usage de les considérer comme des partenaires, ces institutions sont aussi des bénéficiaires lorsqu’elles font appel aux ressources du travailleur de rue.
Le quotidien Par exemple, le travailleur de rue peut être confronté à une rupture sentimentale, une personne en état d’ivresse avancé, une demande de soutien pour développer un projet, un employeur qui ne respecte pas les droits du travail, une bagarre dans la rue, une demande de parents démunis, une visite d’une personne en prison, une jeune fille souhaitant faire une interruption volontaire de grossesse (IVG), une personne dépendante à la cocaïne, un conflit de voisinage dans un quartier, un patron qui se fait du souci pour son apprenti, des relations difficiles entre les forces de l’ordre et certaines populations, etc. En bref, dans la rue et les milieux de vie de la population, il est sur le devant de la scène, le plus souvent aux premières loges. En face de ces diverses situations, dans la mesure de sa capacité à intervenir de manière impartiale, il cherche à créer in situ des espaces de dialogue favorisant la gestion constructive du conflit et la communication sous toutes ses formes. De cette manière, il rend possible un processus où, par la reconnaissance de ce que vit une personne (Ricœur 2004), elle prend conscience à son tour et alors, mais seulement alors, va pouvoir reconnaître l’autre.
Parallèlement, il entretient une relation privilégiée avec un public et peut, à tout moment, être amené à endosser un rôle de médiateur avec ce même public. Un exercice qui ne s’improvise pas complètement, passe par la formation et puise ses ressources dans un espace réflexif de nature à percevoir où se situent les limites de son intervention. Outre sa capacité à créer du lien, la médiation comme outil de gestion de conflit facilite l’expression des non-dits, ouvre une fenêtre sur les émotions, intègre la créativité de chacun et contribue à la résolution de différends sans engendrer de longues procédures (pénales) qui peuvent se révéler coûteuses, tant sur le plan psychologique que matériel.
Les modes de gouvernance D’une manière générale, historiquement, le travail de rue est encore souvent attaché à des institutions privées de type associatif ou fondation. Ces structures jouent un rôle d’interface entre la société civile et des administrations étatiques qui, au nom d’une commune, d’une agglomération de communes, d’un canton ou de la Confédération, peuvent leur octroyer un financement. Une fondation a le projet de développer le lien social sur un quartier et présente un budget au canton pour le réaliser. Une association met sur pied un projet de réduction des risques autour de la consommation de stupéfiants et demande un soutien financier auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). De part leur statut, ces institutions peuvent aussi recevoir des soutiens et dons privés.
Toutefois, depuis une bonne décennie, le travail social de rue est de plus en plus directement rattaché aux administrations communales à dessein de mettre en œuvre leur politique de la jeunesse ou de cohésion sociale. Une telle tendance n’est pas sans poser de questions pour un champ professionnel « atypique » dans ce type d’institution et nécessite une connaissance affinée des enjeux relatifs à son développement, un ajustement particulier en terme de règlement du personnel et une compétence avérée en matière de recrutement ou d’encadrement. A défaut, il n’est pas rare de voir le travailleur de rue passer le plus gros de son temps dans un bureau, un centre d’accueil, une salle de sport ou en réunion. Ou bien, pour le plus compétent et motivé à investir sa mission socio-éducative, d’associer cette forme d’institutionnalisation à « une mise en case administrative » au détriment d’une présence et d’une disponibilité dans la rue et les milieux de vie des populations. En matière de financement, il relève essentiellement du budget des municipalités mais peut aussi faire l’objet d’une demande de soutien auprès du canton ou de la Confédération. A cet effet, entre 2008 et 2015 une commune pouvait p. ex. chercher le financement auprès de l’Office fédéral du territoire (ARE) pour un projet s’inscrivant dans le cadre de « projets urbains ».
En pratique, il est soumis au cadre légal en vigueur dans ces structures privées ou publiques, elles-mêmes s’appuyant sur un appareil législatif plus large comme une loi sur la protection de la jeunesse.
Le développement professionnel Si ce champ professionnel est bien développé sur le plan international2, il se formalise petit à petit dans nos contrées helvétiques et se caractérise par l’élaboration de cahiers des charges, la mise sur pied d’espaces réflexifs et la publication de rapports d’activités, de travaux de recherche ou d’articles. Toutefois, la formation reste au « point mort » en Suisse et, bien que certaines écoles spécialisées ou hautes écoles spécialisées (social et santé) s’y intéressent, le nombre d’enseignements relatifs au travail de rue est insignifiant.
Le travail de rue et la sécurité L’auteur de cet article a récemment publié un ouvrage qui s’appuie sur une vingtaine d’années d’expérience de terrain et reflète un travail de recherche conséquent sur le travail de rue. Cette recherche-action s’est déroulée principalement en Suisse avec le concours de treize autre pays que sont la Hollande, l’Espagne, la Belgique, le Danemark, le Canada, la France, le Portugal, l’Angleterre, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Brésil et le Mexique. Une cinquantaine de personnes – professionnels en travail de rue, représentants des forces de l’ordre, publics en situation de rue, association de professionnels et représentants de la formation en Suisse et au Québec – ont participé. Si le travail (social) de rue est au centre du questionnement, la manière dont nos sociétés investissent dans la sécurité ou la cohésion sociale est réinterrogée, sous l’angle de questions éthiques, sociologiques, politiques et philosophiques.
En Suisse, le profil professionnel du travailleur de rue évolue lentement.
Pour ce qui a trait à la sécurité, le discours des professionnels en travail de rue, étayé par celui des forces de l’ordre et des publics, tend majoritairement à montrer qu’il y a bien, en effet et par effet, une production de sécurité qui s’opère à l’endroit des parcours de vie des personnes avec lesquelles le travailleur de rue est en lien. Dans les situations les plus extrêmes p. ex., les chances d’entrer en lien avec des personnes – en pleine détresse et aux attitudes suicidaires, comme celles qui s’adonnent à des actes terroristes (dans ses formes les plus diffuses d’expressions) – sont quasi nulles si l’on s’en tient essentiellement au déploiement de dispositifs coercitifs ou répressifs. En revanche, par l’entremise de professionnels du lien social, de la détection et de l’intervention précoce ou de la promotion de la santé (niveau individuel et collectif) que sont les travailleurs sociaux de rue, dans la rue et les milieux de vie de diverses populations, avec une attention marquée (et non stigmatisante) auprès de celles exposées à des formes diffuses de maltraitance, d’exclusion ou de précarité, une confiance peut naître et un réel travail d’émancipation peut se mettre en marche.
La sécurité passe par l’émancipation sociale.
- Littérature
- Artison, Vincent (2015) : Le travail social hors murs et les enjeux de sa formalisation. Focus sur les notions de sécurité et d’insécurité, Berne : Peter Lang (traduction allemande en préparation).
- Specht, Walther (2010) : « Mobile Jugendarbeit in Europa », in : Specht, Walther (Hg.); Mobile Jugendarbeit im globalen Wandel – Reaching the Unreachable, Stuttgart: ISMO, p. 78-90.
- Peyre, Vincent ; Tétard, Françoise (2006), « Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée », dans : Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 8/2006, pp. 185-187.
- Ricœur, Paul (2004) : Parcours de la reconnaissance, Louvain-la-Neuve et Paris : De Boeck Supérieur.
- Barber, Benjamin R. (21997) : Démocratie forte [1984], Paris : Desclée de Brouwer (cet ouvrage a inspiré le titre de cet article).
- Maurer, Renato (1992) : Tout va bien – Travail de rue en Suisse 1981-91, Bern : Gruppo Verlauto.
- Alinsky, Saul D. (1976), Manuel de l’animateur social, Paris : Seuil, p. 249 (traduction de Rules for Radicals : A Pragmatic Primer for Realistic Radicals, 1971, New York : Random House).
- 1. Il s’agit de « déminer » tout terrain propice au renforcement d’un phénomène de stigmatisation. A titre d’exemple, si le travail s’effectue uniquement auprès de personnes considérées comme « déviantes » par la communauté, le moindre contact avec l’éducateur de rue serait alors associé à quelque chose de négatif. En résumé, « si je parle avec l’éducateur, c’est que je suis une personne à problème ».
- 2. Cf. les activités de l’ONG Dynamo International : www.travailderue.org.